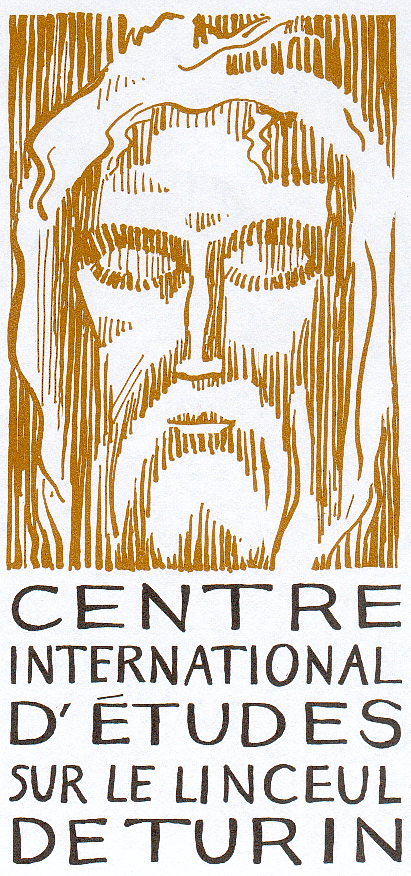Geoffroy de Charny
LA FAMILLE DE CHARNY
La famille de Charny trouve son origine dans le village du même nom, près de Vitteaux en Bourgogne. Le Père Anselme lui donne pour auteur un Ponce de Mont-Saint-Jean, seigneur de Charny au début du XIIIe siècle. Le fils de ce Ponce, Hugues, a eu lui-même pour fils Jean de Charny. Jean sert encore contre les Flamands en 1318 mais meurt peu après puisqu’en 1319-1320 sa fille Isabelle relève un fief qu’il a eu à Troyes (elle meurt elle-même avant 1340). Il a épousé Marguerite de Joinville, la propre fille du célèbre sire de Joinville, biographe de saint Louis. Ils ont eu deux enfants : Geoffroy et Dreux.
Dreux de Charny pose un problème intéressant. Il a épousé en secondes noces, avant 1316, Agnès de Charpigny, fille du seigneur de la Vestitza en Achaïe, voisin du duché d’Athènes. Or un vieil auteur italien, Philiberti Pingoni (1581), raconte qu’une Marguerite de Charny fait sortir le Saint Suaire de Grèce dans son bagage. D’après Fournyer (1641), d’autres auteurs appellent Anne cette Marguerite et il s’agit bien probablement d’Agnès, femme de Dreux de Charny. Agnès de Charpigny serait-elle l’intermédiaire qui aurait assuré le transfert du Saint Suaire d’Orient en France ? On peut en douter si l’on remarque, comme l’a fait Joseph du Teil, que, veuve en 1325, elle a en ses enfants (ou beaux-enfants ?) des héritiers plus proches que son beau-frère Geoffroy.
C’est entre les mains de ce Geoffroy de Charny que le Linceul apparaît vers 1353 à Lirey. Il est seigneur de ce Lirey en Champagne, et aussi de Savoisy et de Montfort, toutes possessions qui lui sont sans doute venues des Joinville. On peut le dire chevalier intrépide et homme de foi. Grand chef de guerre tué à Poitiers en 1356, il a épousé Jeanne de Vergy, d’une grande famille franc-comtoise. Comme elle compte parmi les descendants d’Othon de La Roche, premier duc d’Athènes, on a pu penser qu’elle a apporté le Linceul aux Charny. Mais les témoignages de son petit-fils et de sa petite-fille, Marguerite de Charny, s’accordent mal avec cette hypothèse. Au demeurant, toutes les grandes familles comtoises sont unies par de multiples alliances.
Le fils de Geoffroy, un deuxième Geoffroy, est bailli de Caux en 1387 et de Mantes en 1388, juste avant le fameux mémoire de Pierre d’Arcis. Il prend part à une expédition en Afrique du Nord en 1390 et à la tragique croisade de Nicopolis en 1396. Mort en 1398, il a épousé, sans doute aux environs de 1370, Marguerite de Poitiers, nièce de l’évêque de Troyes, Henri de Poitiers, détail que ne mentionne pas Pierre d’Arcis.
La fille unique de Geoffroy II, Marguerite de Charny, remettra le Linceul à la famille de Savoie qui l’emportera à Chambéry et à Turin.
GEOFFROY DE CHARNY
Personnage clé de l’histoire du Linceul, Geoffroy de Charny est avant tout un chevalier accompli, pieux et vaillant ; et aussi un homme instruit puisqu’il écrit trois livres sur la chevalerie. La guerre de Cent Ans l’amène à combattre en Languedoc en 1337 et en Flandres en 1338. En garnison à Tournai en 1340, il sert en Bretagne en 1341. C’est là, à Morlaix, qu’il est fait prisonnier en septembre 1342 par les Anglais. Il est libéré peu de mois après dans de telles circonstances qu’il manifeste l’intention de fonder une chapellenie, selon un acte de juin 1343 retrouvé par Joseph de Teil. Dès ce même mois de juin 1343, pour l’aider à sa fondation, le roi Philippe VI lui consent l’amortissement de 120 livres de rente. Plus tard, le roi Jean II augmentera le montant de la rente en juillet 1351 et, de nouveau, de 60 livres en juillet 1356. En 1344 et 1345, il a sans aucun doute l’occasion de rencontrer le dernier duc d’Athènes qui, possessionné comme lui en Champagne, sert comme lui à la tête de l’armée française et qui mourra avec lui à la bataille de Poitiers.
Est-ce pour aller chercher le Linceul à la suite de cette rencontre en vue de le remettre à sa future fondation ? Toujours est-il que Charny fait un curieux voyage en Orient. Tous les historiens disent qu’il s’est joint à la petite croisade du dauphin de Viennois pour aller combattre à Smyrne. Mais le seul manuscrit, conservé à la bibliothèque de l’Arsenal, qui parle de son voyage, ne le relie nullement à cette croisade et le place même plus tôt, en 1345. La bataille de Smyrne a lieu le 24 juin 1346. Charny est déjà parti, puisque, le 2 août de cette année, il reçoit les gages de ses soldats à Aiguillon en Agenais.
En 1348, il tente sur Calais un coup de main qui échoue et il se retrouve prisonnier des Anglais. Le roi le fait libérer en payant une rançon de 12 000 écus d’or. Capitaine général de Picardie de 1350 à 1352, il exécute en 1355 une mission secrète en Normandie.
C’est sur ces entrefaites qu’il réalise enfin son vœu et fonde en 1353 le chapitre de la collégiale de Lirey.
En 1355, le roi le nomme porte-oriflamme. Il lui revient dès lors de chevaucher à la tête de toute l’armée en tenant en main le fameux oriflamme rouge de Saint-Denis. La dignité ne se donne qu’à un chevalier d’une prudence et d’une valeur éprouvées ; elle est parfois plus recherchée que celle de maréchal de France. Le porte-oriflamme jure de périr plutôt que d’abandonner la bannière. Le 19 septembre 1356, à la bataille de Poitiers, Charny tient son serment : « là fut… occis messire Geoffroy de Charny, la bannière de France entre les mains », raconte Froissart.
Il laisse une veuve, Jeanne de Vergy, et deux enfants. Son fils Geoffroy a lui-même une fille, Marguerite de Charny, qui transmettra le Linceul à la famille de Savoie.
MARGUERITE DE CHARNY
Si le Linceul séjourne à Lirey grâce à Geoffroy de Charny, c’est par son unique petite-fille qu’il quitte la Champagne. Celle-ci, Marguerite de Charny, née dans les années 1380, épouse vers 1400 Jean de Bauffremont qui meurt en 1415 à la bataille d’Azincourt. Elle se remarie peu après avec Humbert de Villersexel, comte de La Roche, qui la laisse de nouveau veuve, et sans enfants, en 1438.
En 1418, devant les risques de pillage dus à la guerre, elle accueille, avec Villersexel, les joyaux et reliques de la collégiale de Lirey, d’abord dans son château de Montfort puis, très vite dans la collégiale de Saint-Hippolyte. Si, en 1443, Marguerite de Charny rend sans difficulté tous leurs biens aux chanoines, elle en excepte cependant le Linceul. Poursuivie par les chanoines, elle obtient, en échange de dédommagements financiers, une série de délais qui retardent la restitution de la relique. La lutte dure jusqu’à un ultime accord en 1459 et Marguerite de Charny meurt paisiblement le 7 octobre 1460, sans avoir eu à restituer le Linceul. On peut se demander le raisons de son obstination.
Elle a évoqué des raisons familiales qui la font propriétaire de la relique. Le 8 mai 1443, à Dôle, elle déclare : « le Sainct Suaire, lequel pieça fut conquis par feu messire Geoffroy de Charny, mon grand père ». Cette phrase est le seul renseignement positif que l’on possède sur l’arrivée du Linceul dans la famille de Charny. Il faut y ajouter une expression de Geoffroy II, père de Marguerite : liberaliter oblatam, don gracieux » . Dans la phrase de Marguerite, pieça veut dire jadis, et conquis équivaut à acquis (cf. en droit français : acquets et conquêts). Il n’y a pas lieu d’imaginer une action guerrière (conquérir), non plus qu’une réception passive (acquérir est actif). Donc pour Marguerite de Charny et son père, le premier Geoffroy de Charny a pris possession activement et gratuitement du Saint Suaire (un don des ducs d’Athènes ?).
Marguerite n’ayant pas d’enfants, elle ne désire pas garder le Linceul dans sa lignée. En réalité, elle pense la relique trop précieuse pour la modeste collégiale de Lirey et cherche un prince assez puissant et assez pieux à qui la transmettre. Aussi la voit-on en 1449 présenter le Linceul à une foule considérable à Chimay, en Hainaut, mais le clergé et l’évêque de Liège se montrent réticents. En 1452, elle fait encore, sans succès, une ostension au château de Germolles, près de Mâcon.
Enfin, en 1453, elle peut enfin remettre définitivement le Saint Suaire à la famille de Savoie. le 22 mars 1453, le duc de Savoie lui abandonne le château de Varambon en remerciement de « précieux services ».